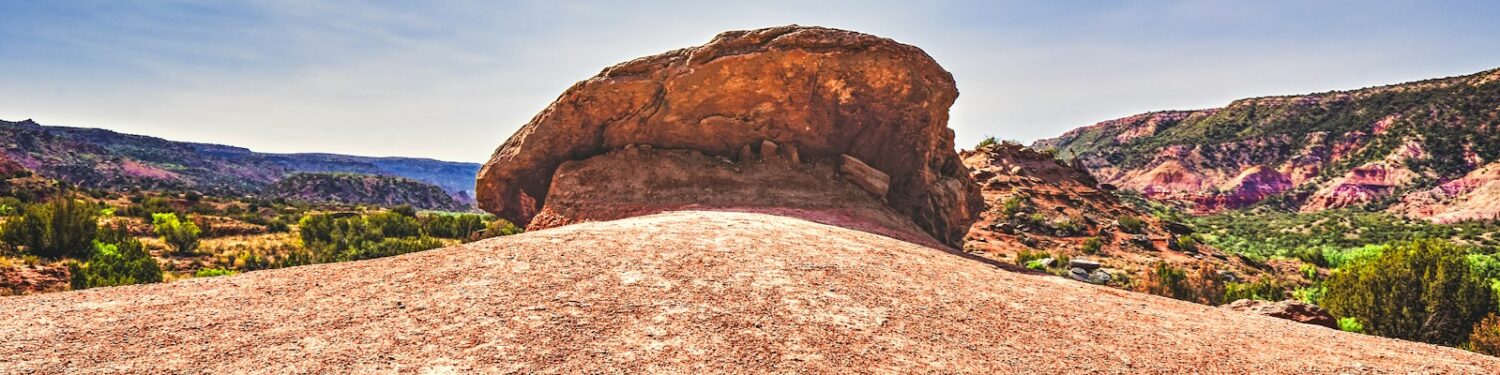L’incontinence urinaire est un problème de santé courant mais souvent minimisé, touchant aussi bien les hommes que les femmes, avec une prédominance chez ces dernières, notamment après un accouchement ou à la ménopause. Définie comme une perte involontaire d’urine, elle peut être légère ou sévère, occasionnelle ou chronique. Bien qu’elle ne mette pas en jeu le pronostic vital, elle altère profondément la qualité de vie, engendrant gêne, isolement social, voire dépression. Heureusement, des solutions thérapeutiques existent, et la prise en charge est aujourd’hui mieux encadrée.
Comprendre les formes d’incontinence pour mieux les traiter
Le choix du traitement dépend du type d’incontinence dont souffre le patient. Les principales formes sont :
- L’incontinence d’effort, qui survient lors d’un éternuement, d’un effort physique ou d’un rire. Elle est due à un affaiblissement des muscles du plancher pelvien.
- L’incontinence par impériosité, provoquée par une envie soudaine et irrépressible d’uriner, souvent liée à une hyperactivité de la vessie.
- L’incontinence mixte, qui combine les deux formes précédentes.
- L’incontinence par regorgement, causée par une vessie pleine qui ne se vide pas complètement, entraînant des fuites fréquentes.
Une évaluation médicale précise, incluant un interrogatoire, un examen clinique et parfois des examens complémentaires.
Premiers traitements : les approches conservatrices
Dans de nombreux cas, les solutions non médicamenteuses sont suffisantes, en particulier lorsque l’incontinence est modérée.
1. La rééducation périnéale
C’est la méthode de référence pour les femmes souffrant d’incontinence d’effort. Elle consiste à renforcer les muscles du plancher pelvien à l’aide d’exercices spécifiques, parfois guidés par un kinésithérapeute. Les exercices de Kegel sont les plus connus et peuvent être effectués quotidiennement à domicile.
2. L’entraînement vésical
Cette technique est indiquée dans les cas d’incontinence par impériosité. Elle vise à rééduquer la vessie en espaçant progressivement les mictions et en contrôlant mieux les envies pressantes. Le patient apprend à uriner à heures fixes, puis à retarder progressivement ces horaires.
3. Les modifications hygiéno-diététiques
De simples changements dans le mode de vie peuvent réduire considérablement les symptômes :
- Réduire la consommation de café, de thé, d’alcool et de boissons gazeuses.
- Boire en quantité raisonnable, répartie sur la journée.
- Éviter les aliments irritants pour la vessie (épices, agrumes).
- Traiter la constipation, qui augmente la pression abdominale.
Les traitements médicamenteux
Lorsque les méthodes précédentes s’avèrent insuffisantes, les médicaments peuvent apporter un soulagement important.
1. Les anticholinergiques
Ils sont prescrits dans l’incontinence par impériosité. Ils sont efficaces, mais peuvent entraîner des effets secondaires : sécheresse buccale, troubles digestifs, somnolence, notamment chez les personnes âgées.
2. Les bêta-3 agonistes
Ces traitements plus récents relaxent le muscle vésical tout en provoquant moins d’effets indésirables. Ils peuvent être utilisés seuls ou en association avec d’autres médicaments.
3. Les œstrogènes locaux
Chez les femmes ménopausées, l’atrophie des tissus vaginaux peut favoriser les fuites.
4. Les traitements spécifiques pour les hommes
En cas d’hypertrophie bénigne de la prostate, certains médicaments (alpha-bloquants ou inhibiteurs de la 5-alpha-réductase).
Les dispositifs médicaux et alternatives
1. Les pessaires
Chez certaines femmes, notamment en cas de prolapsus, un pessaire vaginal peut être placé pour soutenir les organes pelviens et réduire les fuites.
2. L’électrostimulation
Elle consiste à appliquer de faibles courants électriques sur les muscles pelviens pour renforcer leur tonus et améliorer le contrôle vésical.
3. Les protections absorbantes
Elles ne sont pas un traitement mais permettent de mieux vivre au quotidien. Elles doivent être utilisées temporairement ou en complément d’un traitement de fond.
Les interventions chirurgicales
La chirurgie est envisagée lorsque les traitements précédents échouent ou lorsque l’incontinence est trop sévère.
1. Les bandelettes sous-urétrales (TOT ou TVT)
Elles sont posées chez les femmes souffrant d’incontinence d’effort. Elles soutiennent l’urètre et empêchent les fuites lors des efforts.
2. Le sphincter artificiel
Principalement utilisé chez les hommes, notamment après une chirurgie de la prostate, ce dispositif implanté permet de contrôler l’ouverture de l’urètre à l’aide d’une pompe.
3. Les injections de toxine botulique
Le Botox® peut être injecté dans la paroi de la vessie pour bloquer les contractions involontaires. C’est une solution efficace mais temporaire, à renouveler tous les 6 à 12 mois.
4. La neuromodulation sacrée
Elle consiste à stimuler électriquement les nerfs contrôlant la vessie à l’aide d’un implant. C’est une alternative efficace dans les cas d’incontinence résistante aux autres traitements.
Conclusion
L’incontinence urinaire n’est pas une fatalité. Grâce aux nombreuses options thérapeutiques disponibles aujourd’hui, il est possible d’en réduire considérablement les effets, voire de la guérir dans certains cas. La clé réside dans un diagnostic précis, un accompagnement personnalisé et une approche globale. Retrouver le contrôle de sa vessie, c’est aussi retrouver confiance en soi et qualité de vie. TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE CASABLANCA